Article N° 8022
MICROBIOTE
Le CHUV décroche l’AMM d’un médicament issu du microbiote fécal
Abderrahim DERRAJI - 01 février 2025 12:45Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a réalisé une avancée majeure dans le traitement des infections intestinales en obtenant l’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un
médicament de transfert de microbiote fécal (TMF), une première en Suisse. Ce traitement innovant consiste à transférer une partie de la flore intestinale provenant des selles d’un donneur sain, transformée en médicament, pour restaurer la flore intestinale des malades. Pour l’instant, ce traitement cible les infections à Clostridium difficile, une bactérie responsable de diarrhées sévères et de récidives fréquentes, affectant un patient sur quatre.
Contrairement à d’autres pays où le macrobiote fécal est considéré comme un «tissu», la Suisse le classe comme un médicament non standardisable, soumis à des normes strictes de fabrication, de contrôle, de suivi et de traçabilité, similaires à celles des médicaments produits par l’industrie pharmaceutique. Le CHUV est devenu de ce fait le premier hôpital public à produire un médicament sous ces conditions rigoureuses.
La sélection des donneurs est particulièrement stricte : seulement 10 % des candidats sont retenus après des tests cliniques et biologiques approfondis. Chaque donneur effectue en moyenne huit dons par mois, permettant de produire une douzaine de traitements utilisables pendant deux ans, tout en assurant une
traçabilité complète.
Grâce à cette AMM, le médicament pourra être utilisé par d’autres hôpitaux partenaires en Suisse, élargissant l’accès des patients à ce traitement sans équivalent pour les infections à Clostridium difficile. Le CHUV espère également que cette innovation stimulera la recherche sur le microbiote intestinal et son rôle dans la santé humaine, un domaine en pleine expansion.
Cependant, pour faciliter l’accès à ce traitement, une prise en charge par l’assurance maladie de base est essentielle. Une demande a été soumise à l’Office fédéral de la santé publique en ce sens.
Cette avancée représente une lueur d’espoir pour les patients souffrant d’infections intestinales récurrentes et ouvre la voie à de nouvelles perspectives thérapeutiques.
Source : rts.ch
 Évenements
Évenements

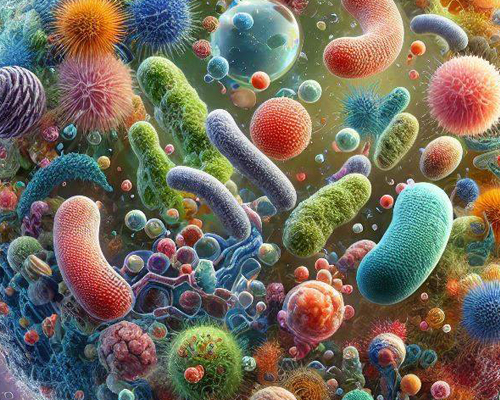
.jpg)
.jpg)